Une observation attentive des monuments funéraires permet de recueillir de précieux renseignements. Les détails visibles aujourd’hui, tels que les inscriptions et les motifs sculptés dans la pierre, offrent une véritable source d’informations. À travers ces éléments, il est possible d’obtenir des révélations et des précisions sur les personnes auxquelles ces monuments sont dédiés.
En premier lieu, les noms des défunts sont clairement inscrits sur chaque monument. On relève également la mention des dates de décès, et parfois même de naissance, ce qui permet de situer la période à laquelle ces individus ont vécu. Les fonctions, professions ou rangs occupés par ces personnes à leur époque figurent également parmi les informations communiquées, apportant un éclairage sur leur statut social et leur rôle au sein de la communauté.
Enfin, les liens familiaux sont mis en évidence par la présence d’armoiries et de blasons gravés sur le pourtour des monuments. Ces symboles héraldiques facilitent l’identification des familles et illustrent la filiation ou les alliances entre les différents membres mentionnés. Ainsi, chaque stèle funéraire devient un témoin précieux de l’histoire locale et familiale, offrant au visiteur une lecture approfondie du passé à travers la pierre.
DALLE MORTUAIRE DE CLAUDE WAHA (1558) ET CATHERINE D’AYSAUX (1560)
 Située contre le mur sud, au niveau du chœur, cette dalle mortuaire a été sculptée dans du calcaire noir de Meuse. Claude de Waha, membre de la noblesse luxembourgeoise et grand bailli de Poilvache, occupait également la fonction de 12ème seigneur de Baillonville. Il était marié à Catherine d’Aysaux.
Située contre le mur sud, au niveau du chœur, cette dalle mortuaire a été sculptée dans du calcaire noir de Meuse. Claude de Waha, membre de la noblesse luxembourgeoise et grand bailli de Poilvache, occupait également la fonction de 12ème seigneur de Baillonville. Il était marié à Catherine d’Aysaux.
L’œuvre est attribuée au maître sculpteur de Sclayn. Sur la tranche du monument, une inscription rédigée en capitales romaines mentionne les noms et fonctions des deux défunts. Au-dessus du gisant, on retrouve des blasons représentant les familles respectives, illustrant ainsi leur appartenance et leur statut au sein de la noblesse.
DALLE MORTUAIRE DE JEAN DE WAHA (1624) ET MARGUERITE DE MÉRODE (1636)


La dalle funéraire de Jean de Waha, remise à jour récemment en 2023, présente une histoire marquée par plusieurs transformations. A l’occasion des travaux réalisés en 1966, consécutifs à la suppression du maître-autel selon les nouvelles directives liturgiques Vatican II, qu’elle fut encastrée au niveau du sol, du côté sud du chœur. Durant les années 1980, elle avait été dissimulée sous un plancher, ce qui avait temporairement masqué sa présence aux yeux des visiteurs et des fidèles.
Cette dalle, taillée dans le calcaire noir de Meuse, se distingue par la disposition des blasons familiaux qui ornent son pourtour, attestant de l’appartenance de Jean de Waha à une lignée noble. Jean de Waha, qui fut le quatorzième seigneur de Waha, repose ainsi sous un monument dont la valeur symbolique et historique est renforcée par la présence de ces armoiries. Il est également important de noter que la dalle porte encore aujourd’hui les traces du passage des révolutionnaires, ce qui laisse supposer qu’elle a été enterrée après la Révolution française, bien que la date exacte de cette inhumation demeure inconnue.
PIERRE COMMÉMORATIVE AVEC INSCRIPTION WAHA NAMUR (1628)
 La pierre commémorative gravée des armes martelées « Waha Namur 1628 » occupe une place particulière parmi les monuments de l’église. Contrairement aux autres stèles abordées, celle-ci n’est pas de nature funéraire, mais bien commémorative. D’après l’historien Jean-Louis Javaux, cette pierre aurait probablement été apposée afin de rappeler des travaux réalisés à la chapelle en 1628.
La pierre commémorative gravée des armes martelées « Waha Namur 1628 » occupe une place particulière parmi les monuments de l’église. Contrairement aux autres stèles abordées, celle-ci n’est pas de nature funéraire, mais bien commémorative. D’après l’historien Jean-Louis Javaux, cette pierre aurait probablement été apposée afin de rappeler des travaux réalisés à la chapelle en 1628.
Une photographie datée de 1944 témoigne de l’emplacement initial de cette pierre, alors installée à l’extérieur, dans le cimetière jouxtant l’église. Ce n’est que dans un second temps qu’elle fut déplacée à l’intérieur de l’édifice. Elle constitue ainsi le dernier ajout de ce type, intégrée sur la paroi sud, dans le porche d’entrée.
DALLE MORTUAIRE DU CHANOINE HENRI DE WAHA (1631)
Cette dalle commémore Henri de Waha, chanoine de Saint-Lambert à Liège. Frère de Jean de Waha, dont la dalle est localisée dans le chœur au numéro 2, elle est réalisée en calcaire de Meuse et présente un blason martelé, dont la franche gauche est manquante. Au-dessus du blason, placé dans la partie inférieure où figurent le nom et la fonction du chanoine, se trouve un autre écu, fortement détérioré par le temps et lors du passage des révolutionnaires, qui reprend les armoiries familiales.
DALLE MORTUAIRE DE NICOLAS DE WAHA (1636) ET CATHERINE DE NAMUR (1674)
La sépulture de Nicolas de Waha est située dans le chœur de l’église, au niveau du sol, côté nord. Nicolas de Waha est décédé à l’âge de quarante ans, emporté par la peste, deux mois seulement après le décès de sa mère, dont la dalle est référencée sous le numéro 2. Avant sa mort, il avait pris soin de préciser que ses funérailles ne devaient donner lieu à aucune manifestation ostentatoire, à l’exception d’une célébration religieuse réunissant trente à quarante prêtres. Il avait également demandé que douze flambeaux soient recouverts d’un drap noir d’une longueur de cinq aunes, orné d’une croix de taffetas blanc. La dalle, réalisée en calcaire de Meuse, a subi le même type de dégradations que celle de Jean de Waha (n° 2), témoignant du passage du temps et des événements historiques qui ont marqué ces monuments.
André Vanoverschelde
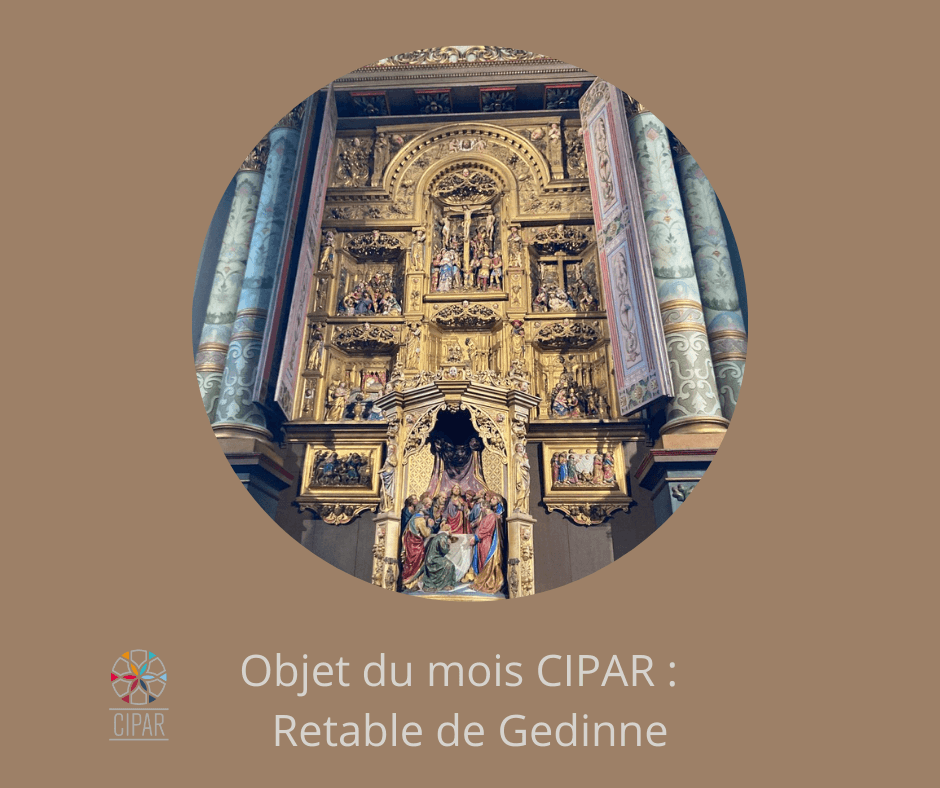
 A la fin de l'année 2025, les étudiants de Bac 3 du département d'Histoire de l'art et Archéologie de l'UNamur ont eu l'opportunité de participer sur base volontaire à un atelier d’initiation à la réalisation d’un inventaire d’église, organisé par Maura Moriaux de l’équipe du
A la fin de l'année 2025, les étudiants de Bac 3 du département d'Histoire de l'art et Archéologie de l'UNamur ont eu l'opportunité de participer sur base volontaire à un atelier d’initiation à la réalisation d’un inventaire d’église, organisé par Maura Moriaux de l’équipe du 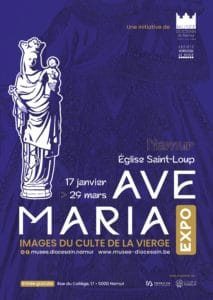
 Située contre le mur sud, au niveau du chœur, cette dalle mortuaire a été sculptée dans du calcaire noir de Meuse. Claude de Waha, membre de la noblesse luxembourgeoise et grand bailli de Poilvache, occupait également la fonction de 12ème seigneur de Baillonville. Il était marié à Catherine d’Aysaux.
Située contre le mur sud, au niveau du chœur, cette dalle mortuaire a été sculptée dans du calcaire noir de Meuse. Claude de Waha, membre de la noblesse luxembourgeoise et grand bailli de Poilvache, occupait également la fonction de 12ème seigneur de Baillonville. Il était marié à Catherine d’Aysaux.

 La pierre commémorative gravée des armes martelées « Waha Namur 1628 » occupe une place particulière parmi les monuments de l’église. Contrairement aux autres stèles abordées, celle-ci n’est pas de nature funéraire, mais bien commémorative. D’après l’historien Jean-Louis Javaux, cette pierre aurait probablement été apposée afin de rappeler des travaux réalisés à la chapelle en 1628.
La pierre commémorative gravée des armes martelées « Waha Namur 1628 » occupe une place particulière parmi les monuments de l’église. Contrairement aux autres stèles abordées, celle-ci n’est pas de nature funéraire, mais bien commémorative. D’après l’historien Jean-Louis Javaux, cette pierre aurait probablement été apposée afin de rappeler des travaux réalisés à la chapelle en 1628.